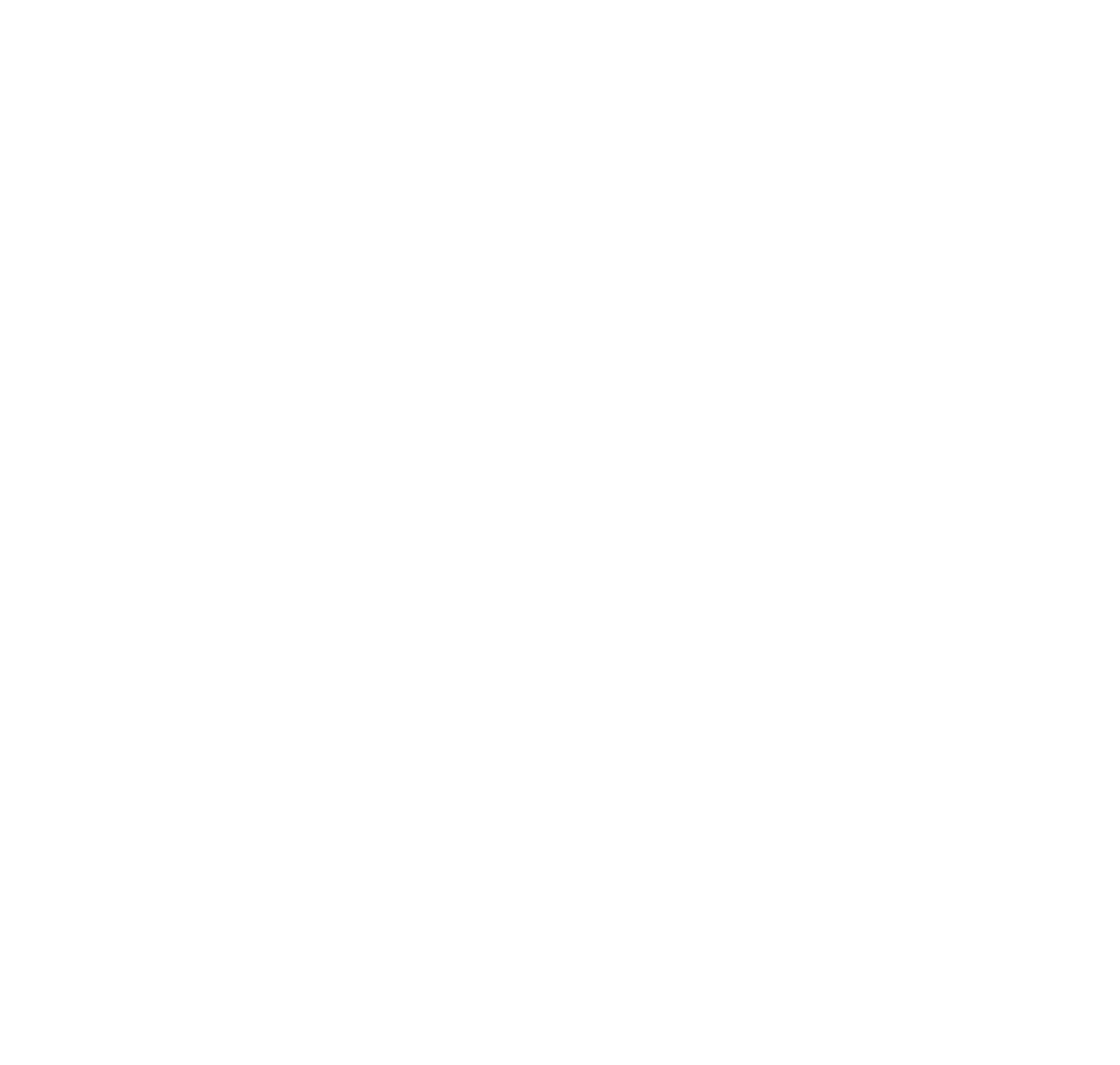Nous y voilà dans cette forêt, précisément sur la rive rocailleuse du Jatunyako, un affluent grondant de l’Amazone, où nous nous fixons le premier objectif de l’expédition : nous défaire de notre mode de pensée occidental pour mieux appréhender cet environnement, autrement dit mettre de côté l’intellect pour nous concentrer sur notre sensibilité stimulée par l’exubérance alentour.
Hervé Maigret rappelle aux artistes la méthode. Pendant une vingtaine de minutes, chacun doit s’imprégner de l’endroit et capter une idée d’expérimentation, puis nous nous réunissons à nouveau pour décider d’en suivre quelques-unes, individuellement ou à plusieurs.
Les danseurs se dispersent. D’un côté, Tamia Sanchez, l’étudiante de l’Université de Guayaquil, va près d’une source y puiser son inspiration en contraste sonore avec le fleuve grondant à côté; de l’autre, Hervé Maigret recherche la perte d’équilibre en laissant ses pieds trouver le sens donné par chaque cavité rocheuse; une approche semblable à celle d’Emilia Benitez, dont les doigts suivent les sinuosités des pierres, esquissant de précis et précieux mouvements ; et à celle d’Omar Aguirre allongé sur un roc qui lui dicte de doux lancés de jambes.
Ces expérimentations chorégraphiques donneront lieu, peu après, à un lent bal épousant la forme et, semble-t-il, le temps des minéraux gris plomb sous la lumière écrasante amadouée par le photographe Didier Maigret. Cela pourrait être une allégorie des iguanes des îles Galapagos, puisqu’on est en Equateur, mais il s’agit plutôt d’un hymne à la scénographie la plus pure qui soit.
Votre serviteur écrivain, égaré au bord du fleuve, lui, suit à la lettre la consigne du jour, « se défaire de nos habitudes occidentales », en faisant par mégarde tomber son stylo à l’eau, un produit marketing de la Banque nationale argentine. Lui vient alors l’idée d’expérimenter la perte du langage. S’ensuit un grand soulagement face aux milliers d’espèces végétales et animales l’entourant, dont il ignore le nom. Tous deviennent des arbolus verdus magnificus décorés de lianas quireveillelesingequisommeilenus. Les nuages de papillus trecolorus l’émerveillent et le font lui demander si leurs noms kichwa travaillés au fil des siècles comme ces jolius caius polix sculptées par l’eau au cours des millénaires l’en rapprocheraient plus ou moins que les termes de la Royal British Academy.
Le musicien Rodrigo Becerra a pris cette consigne à rebrousse-poil. Il enregistre les sons de caillou percutant le roc et ceux de branches frottées l’une contre l’autre pour, dit-il, « en restant dans la mentalité du machinisme et du productivisme chronométré, en faire la matière première d’une musique électronique ». Celle-ci devrait d’ailleurs fournir la bande-son de l’allégorie dansée collective au ralenti.
Mais c’est le plasticien Serge Crampon, subjugué par la beauté d’un bassin bordé par de falaises, qui est allé le plus loin dans l’expérimentation, aujourd’hui, en recouvrant son corps nu de boue, pour en imprimer les marques sur un tapis de papier sulfuré qu’il a aménagé pour cette performance. On l’a vu sortir de l’eau comme le premier homme, puis se retourner vers le soleil, reprendre sa lente marche en avant et enfin ramasser le papier marqué pour s’en faire un habit. « C’est le lieu qui m’inspire avant tout, dit-il. Il y a un entre-temps entre le premier et le second pas dans la marche en avant, dit-il. Or, cet espace ne se mesure pas dans la temporalité. »
M-H. A.