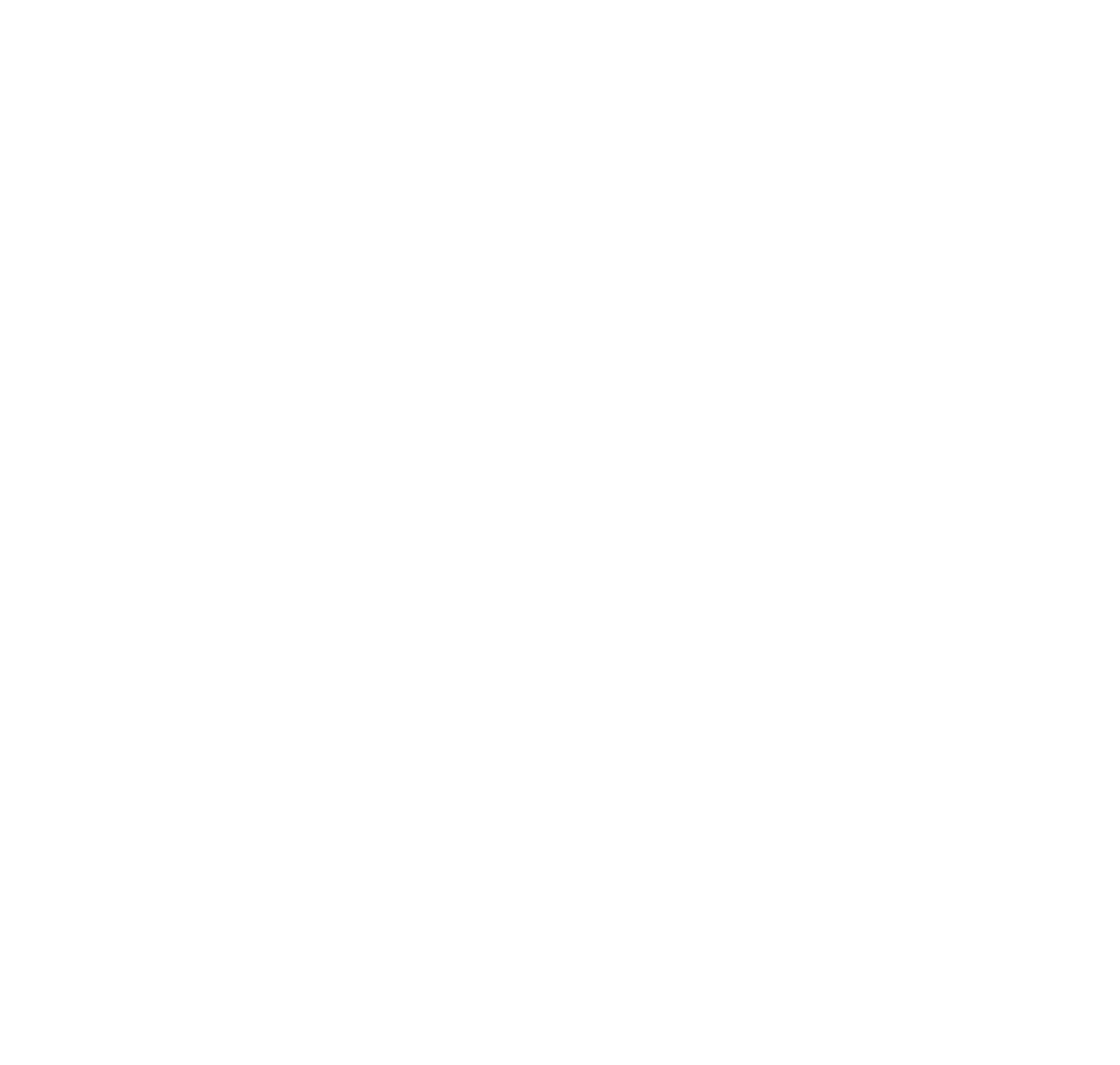Le 6 octobre, sur un flanc du volcan Ruca Pichincha.
Les nuages qu’ils ont vus naître dans la jungle rattrapent les artistes en remontant la vallée de Quito. À 4 000 m d’altitude, avec le soleil absent, une vaste monochromie brune et verte les accueille entre ciel et roche. « Le vide et le plein s’appellent, ils se révèlent », remarque le peintre, Serge.
Les flancs du volcan sont revêtus de páramo, une herbe dense et rase que les danseurs foulent sensuellement parmi l’hostile et le grandiose. Leurs jambes y poussent, cisaillent l’air : ils expérimentent in situ leur rapport à l’espace. Même à quatre et photographiés en plan large, ils demeurent infimes et s’essoufflent. Après la forêt amazonienne et son plein d’oxygène, au sommet des Andes, l’élément O leur manque. Comme eux, au lieu de se développer en hauteur, la végétation là-haut croît au ras du sol.
Puis, ils se balancent dans le vide au-dessus de Quito. Une planche, deux cordes et un volcan leur suffisent pour voir défiler à l’envers, puisqu’ils sont des enfants et qu’ils renversent la tête en arrière, l’ancienne cité inca, ce jour-là comme recouverte de cendres à travers les nuages.
Un arbre, un seul, habite ce domaine, et lui seul est à leur échelle. C’est l’arbre à papier. Son tronc tout fin, si dur, est pourtant constitué de feuilles dorées qui partent au vent. Serge en emporte sans savoir ce qu’il en fera. Ces lumières qu’il chérit au premier coup d’œil, sitôt parties, il se contente de les regarder pour en garder l’impression qu’il recyclera dans son atelier où l’esprit est indissociable de sa main.
Lointains, pentus, cassés, les horizons aperçus du volcan sont difficiles à rendre, alors Didier le photographe recourt à l’avant-plan. « Avec un bon portable, aujourd’hui, n’importe qui peut faire de super photos, dit-il. Mais l’œil, cet outil magnifique, encore inégalé, voit à la fois le large et le serré. Il restitue la beauté au cerveau », conseille-t-il à Luis, l’étudiant devenu bon gré mal gré son apprenti au cours de notre péripétie.
M.-H. A.