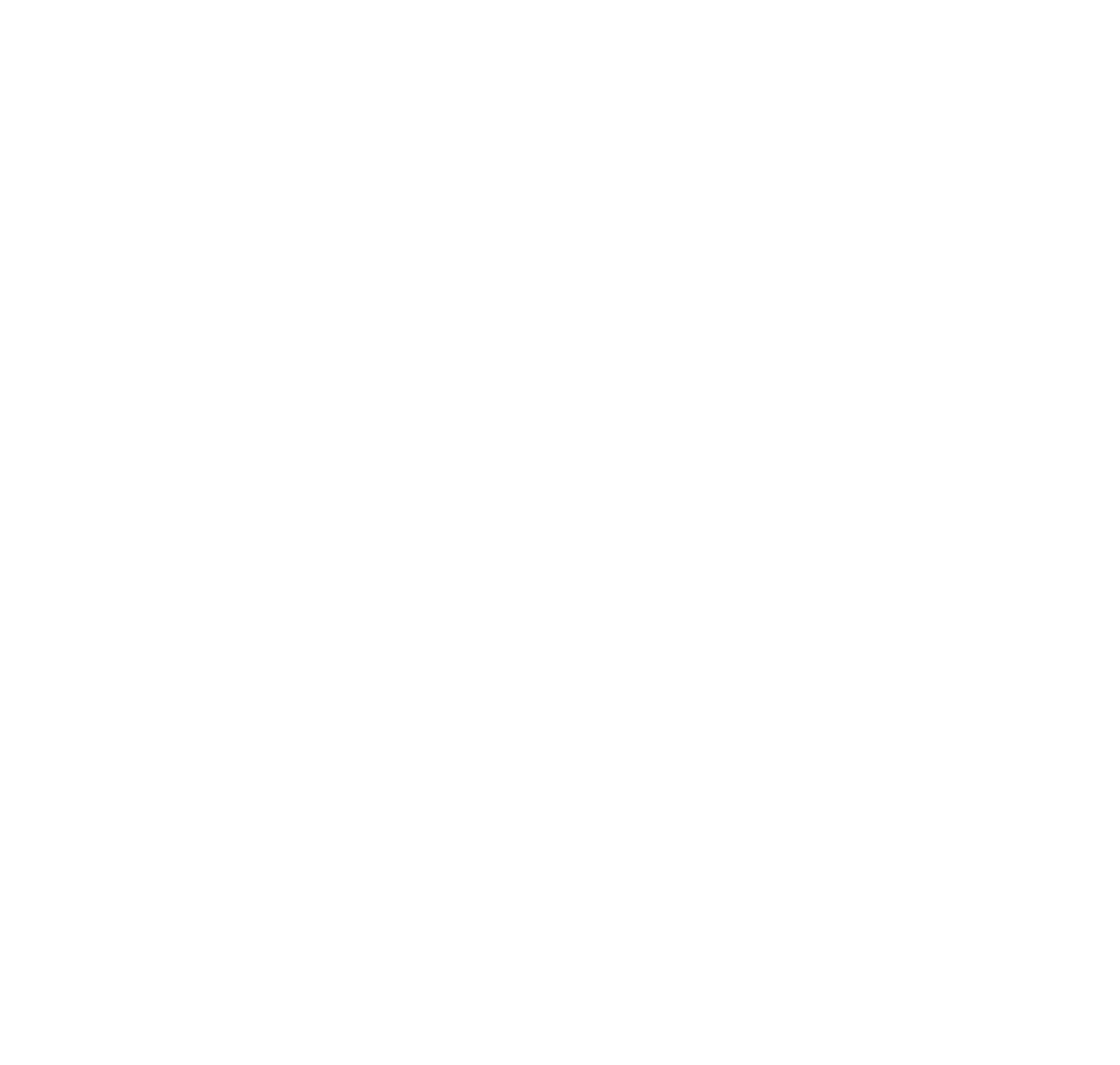Le 30 septembre, village de Shiripuno, région de Napo. La deuxième étape de l’expédition consiste à collaborer avec la communauté kichwa du village de Shiripuno, d’à peine deux-cent habitants, situé au bord de l’immense fleuve Napo, modeste affluent de l’Amazone que l’on traverse en pirogue. Un orage éclate au loin, le ciel passe du bleu au gris métallique, devient cendre. Le chant des oiseaux invisibles semblent les sirènes d’un couvre-feu. Notre caméraman, Didier Maigret, saisit le travelling et « prend [son] pied » à filmer l’atmosphère d’avant pluie en contre-jour. Par le jeu des contrastes de lumière, il estompe la ligne d’horizon entre le ciel et la végétation. « La pluie donne du caractère à l’image, dit-il. Avec les moyens techniques actuels, il possible de contrôler la lumière, la pluie beaucoup moins. De fait, sur les tournages, elle est souvent artificielle », précise-t-il. Alors que notre pirogue ralentit, le musicien Rodrigo Becerra enregistre le bruit du moteur sous le clapotis de l’eau, un rythme qu’il utilisera pour l’ambiance sonore de la performance à venir.
De ce côté-ci de l’Amazonie, pas de fusées qui partent comme en Guyane, mais des flèches pour jouer vendues en guise de souvenirs par de jeunes filles en pagne au pourtour des yeux peint en rouge, un brin tristes, qu’on devine déguisées pour l’impression faite au touriste. Une vieille indienne passe un python domestiqué de cou en cou pour une photo facturée un demi-dollar. Les habitants de Shiripuno vivent de l’exploitation aurifère et du tourisme dit communautaire. Dans la hutte qui tient lieu de boutique de bijoux, ni employé, ni caméra de surveillance.
Sitôt après notre arrivée, les enfants du village se ruent à l’atelier danse improvisé par Hervé sur la berge du fleuve où se dressent, côté à côte, deux hibiscus comme les piliers de la porte d’un temple. Les enfants la franchissent en marchant en direction du fleuve pour aller chercher les danseurs et la refranchir avec eux, main dans la main. Un exercice tout simple réalisé non sans difficulté. « La porte est le symbole de l’initiation. On passe notre vie à ouvrir et fermer des portes. Partout dans le monde, les enfants restent des enfants, ouverts. Ils sont à l’écoute de l’action, pas de l’intellect, et ça fait beaucoup de bien », commente le chorégraphe. Puis, Omar les fait danser en mimant successivement les arbres, les grenouilles, les oiseaux et les poissons « que le fleuve emporte » ; les danseurs soulèvent les enfants à bout de bras. Ils en sont heureux. Pendant ce temps, les pieds dans l’eau, leurs mères extraient du fleuve des particules d’or, presque une à une. A fond de leur tamis brillent trois, quatre points minuscules du métal coté à la bourse de Londres. À raison d’un gramme récolté par semaine payé trente-cinq dollars, ce n’est toujours pas l’Eldorado.
Le second atelier est musical : les rires font place au silence imposé par le violoncelle de Rodrigo Becerra. Un garçon d’une dizaine d’années s’y essaye, ne le lâche plus. Une vocation est peut-être née. Au même moment, une de ses camarades entonne un chant kichwa d’une voix superbe, un hymne au toucan, en jouant du tambour. Le moment sonore est déjà retenu pour la restitution de l’expédition artistique, laquelle sera donnée bientôt, d’abord à l’Alliance Française de Quito puis dans les écoles de la région nantaise.
Dans cette optique, sur un papier fin de 2 m sur 50 cm, Serge finit de peindre à l’aide de crayons gras un lit de galets sous l’eau, inspiré par le thème des apparitions et des disparitions. Il est, parmi les onze artistes de l’expédition, le plus lucide sur les limites de celle-ci. « Nous travaillons dans l’urgence. Nous expérimentons tout en reproduisant des acquis dans un lieu différent. C’est une mise en commun de nos savoirs », glisse-t-il. Pour parachever l’oeuvre, il sollicite la marche délicate de la jeune danseuse Tamia, dont la marque des pieds enduits de poudre de bois de santal s’imprime sur le papier. La pellicule d’eau recouvrant les galets apparaît soudainement.
C’est l’eau également qui avait inspiré un chant à la belle Emilia Benítez lorsqu’elle évoluait sous la cascade du Diable, la veille, au Lagon Bleu. Elle avait vu l’arc-en-ciel dans les gouttes chutant et senti de la gratitude pour l’énergie reçue. « Ce chant sans parole fait écho aux vibrations de l’eau. J’ai voulu lui donné quelque chose en retour », se souvient-elle. Le jour d’après, elle y entrait de nouveau, jusqu’au bassin, dans une rivière dodelinant sous l’épaisse forêt amazonienne, une eau si tranquille qu’elle lui inspira, par contraste, des sentiments guerriers. Ses bras sur la défensive fendaient l’ombre des feuilles percée de lueurs.
Maintenant rendus à Shiripuno, à la tombée du soir, l’orage craque au-dessus du village en y déversant une pluie chaude et apaisante. Spontanément, Tamia Sánchez se met à danser sous la pluie. Son corps mince se cambre au bruit du tonnerre et s’arque-boute sous le poids des gouttes éclatant sur son front. Elle interprète l’éclair, sans trop en faire. Et finit comme elle a commencé, la paume des mains tournée vers le ciel, puis s’accroupit lentement, gît au sol la joue contre la terre buvarde.
La veille, elle nous disait ce poème écrit en revenant de la cascade du Diable :
Comme si j’existais en toi
Je le sais quand je te touche
Quand tu glisses
Le long de mes bras
Et de mes jambes
Tu pèses
Tu ne m’effraies pas, je te respecte, t’accepte
Tu es forte, tu tombes
Sans demander permission
à personne
Te laisses-tu prendre ?
Jamais
Tu me séduis, tu me laisses
M’inonder en toi
Puis tu m’expulses
Agressive, inconnue, distante
Autre
Tu es toujours une autre
En kichwa, Tamia signifie « pluie ».
M-H. A.