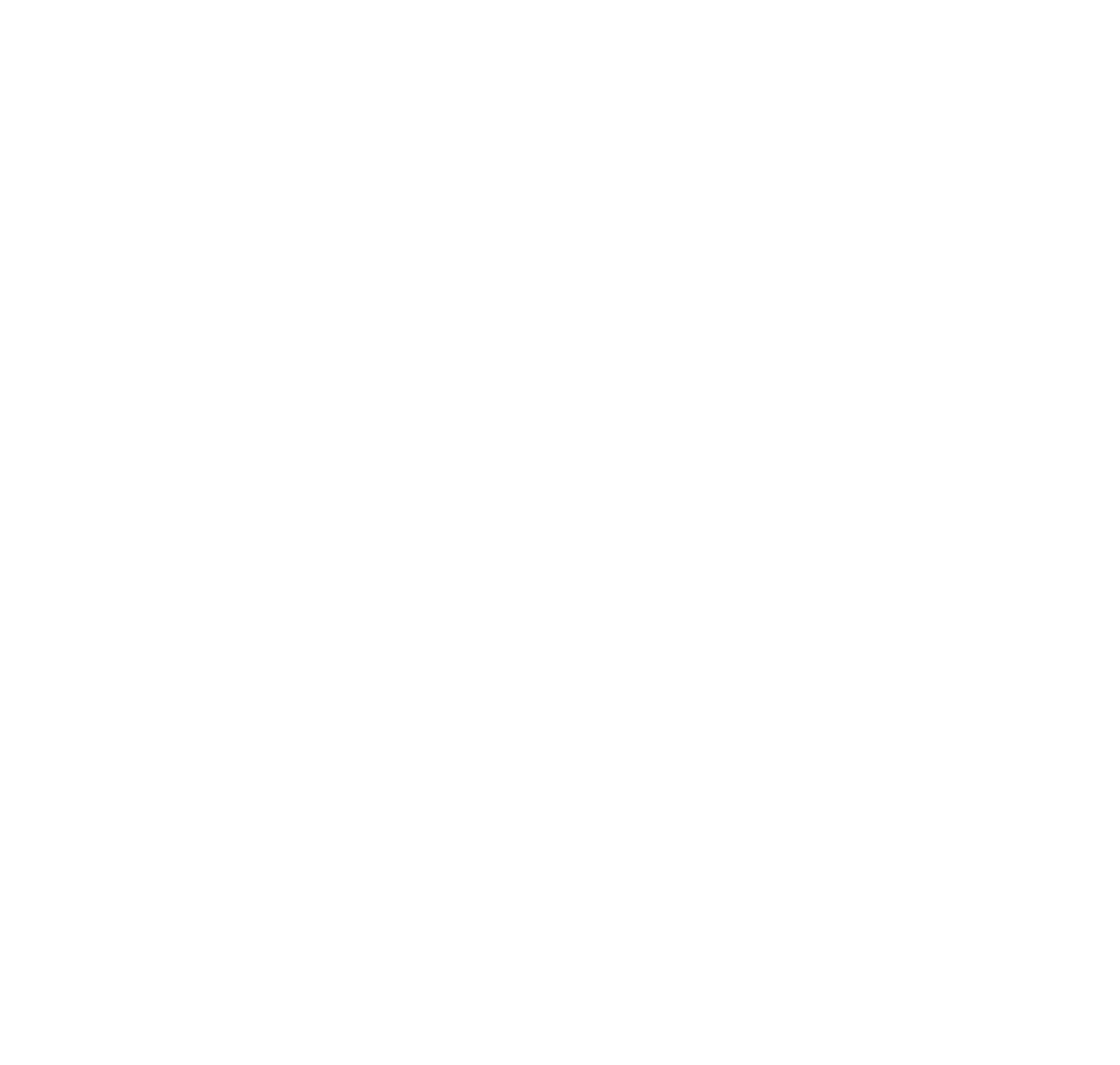Ce sera le clou du spectacle, si spectacle il y aura. Nous sommes là pour expérimenter, pas pour créer. Dans cette forêt luxuriante et pourrie, où tout éclot et se décompose à vue d’oeil, que nous crapahutons et dévalons à reculons en s’agrippant aux branches qui cèdent et aux racines qui lâchent leur lot d’insectes fluorescents, nous découvrons une nouvelle gamme de mouvements précis et synchronisés. Le groupe de danseurs contemporains progresse lentement sur une crête, en file indienne, derrière un guide kichwa armé d’une machette. « Utilisez la mémoire du corps », conseille haletant le chorégraphe Hervé Maigret. Nos pas s’impriment sur la boue autant que la boue imprime leur rythme cassé. Nous avons des fourmis dans les jambes, des rouges qui rentrent dans nos bottes remplies de sueur, qui font « floc » à chaque pas. Rendus dans un marais, nous nageons plus que nous ne marchons entre des plantes aux formes de corail et d’arbres ornés d’hippocampes minimalistes et d’étoiles rouges à cinq branches.
Une rivière apparaît soudainement. La végétation est si dense que son bruit ne passe pas. Le lit de galets ondule sous un toit végétal qui filtre la lumière du zénith. Premier arrêt du jour, premières expérimentations. La jeune Tamia choisit pour scène une pierre émergée où seul son pied peut prendre place, tandis que l’autre en caresse le bord poli ; elle s’accroupit, rince ses jambes sans forcer la beauté du geste et se redresse au ralenti ; face à elle, Hervé hurle en silence juché sur une roche recouverte de mousse, pris de spasmes qui le font se jeter à l’eau. Encore essoufflé, il demande à l’acteur Équatorien Omar de s’habiller en clown écolo. De l’autre rive, Julie la philosophe lui dicte en criant une consigne adressée aux enfants: « Notre monde est absurde mais tout n’est pas foutu. Son sort dépend de votre imagination ». Il s’exécute.
Le soir, de retour à la station balnéaire indigène, nous faisons un premier bilan de l’expédition sous l’oeil de la famille kichwa qui nous sert une soupe de yuca. « Je me sens un conquistador bien que l’Amazonie fasse partie de mon pays », avoue Omar. « Nous ne sommes pas des conquérants. Nous faisons écho à une tradition européenne d’exploration que nous voulons rénover », rétorque Julie. « Je suis toujours dans l’ambigüité », renchérit Hervé. Je veux donner lieu à des performances qui se suffisent à elles-mêmes et, en même temps, je veux qu’elles soient filmées pour les partager. Je veux envahir cet espace sans le violer, seulement en faire partie », dit-il. Le plasticien Serge Crampon intervient : « Pour moi, l’important n’est pas la présence ou l’absence des caméras, ni que ce fleuve s’appelle l’Amazone ou la Loire. L’important est le geste, le moment et l’émotion qui s’en dégage », dit-il. « Notre collectif est né aujourd’hui dans la forêt, grâce à elle », reprend Hervé.
Le lendemain, au bord du fleuve, s’improvise une danse avec des papillons jaunes. « L’art a tendance à pacifier », remarque Serge, ému face aux trois interprètes féminines dont ils ne manquent que des ailes pour voler. Mais faut pas s’y fier, ajoute-il. Un seul battement peut faire chavirer le monde. »
L’instant d’après, parvenu à un coude du fleuve, Omar aperçoit un amas de troncs déposés sur la berge et propose aux danseurs d’y évoluer. Même le vidéaste Luis, de l’université de Guayaquil, prend part à cet amalgame de bois et de chair avec sa caméra qui ne fait pas tâche. Ce jour-là, les Équatoriens ont repris le pouvoir.
M-H. A.