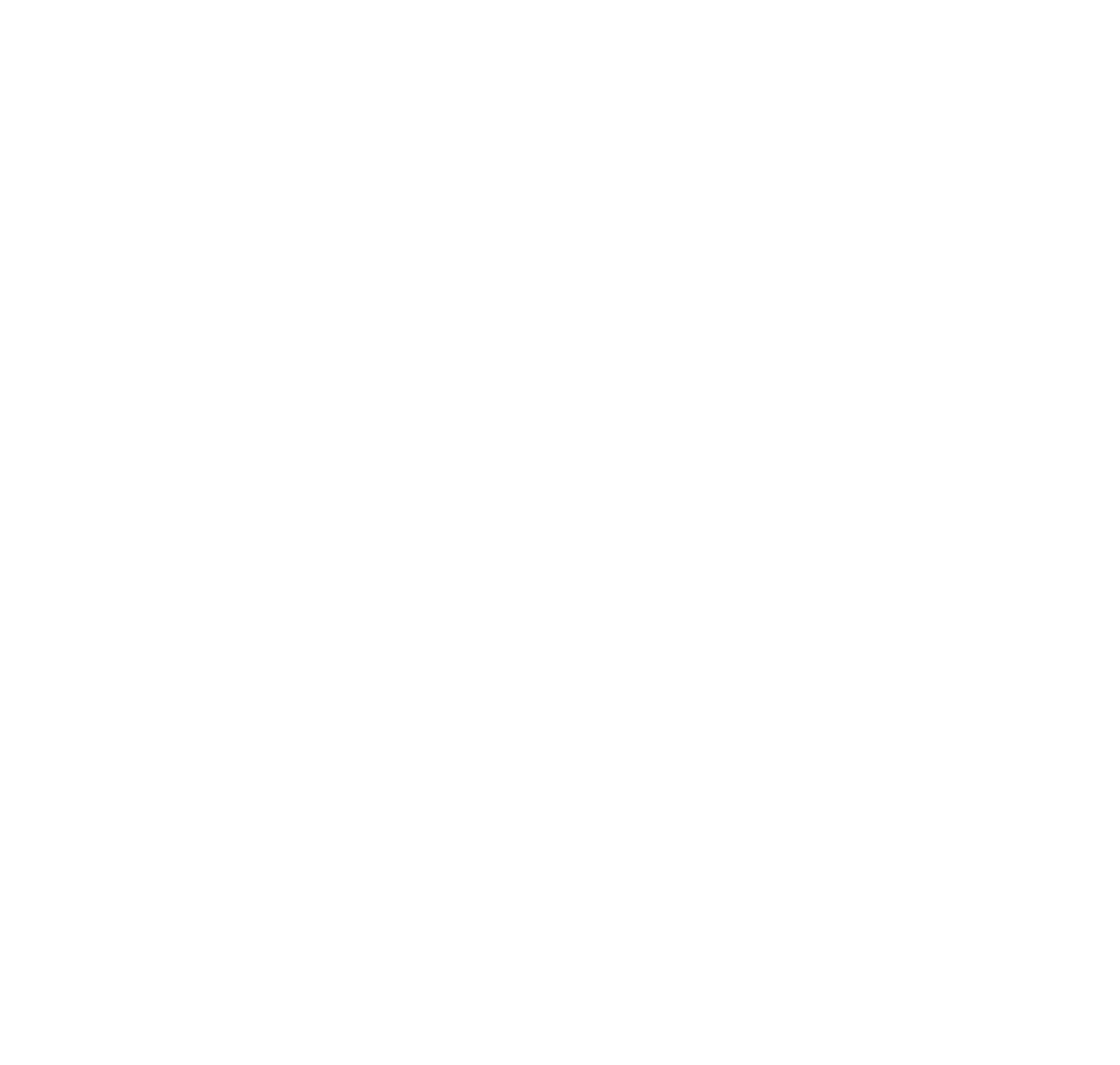-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Texte philosophique 9 – Peut-on encore découvrir quelque chose ?
10 octobre 2018Se rendre sur ces terres amazoniennes faisait écho à une longue tradition d’expéditions scientifiques qui ont eu lieu dans le passé. Nous avons été des explorateurs, oui, mais des explorateurs qui ne veulent plus que « découvrir » puisse encore être le synonyme de « posséder » mais bien plus celui de « préserver ». Nous sommes des explorateurs artistes qui ne possédons rien d’autre, au plus profond de nous, qu’une seule arme, à la fois si désuète nous dit-on mais en même temps si puissante, nous n’avons qu’un seul outil de compréhension et d’échange : notre rapport intime à l’humain et à l’universel.
C’est en rentrant au plus profond de nous-mêmes, dans une démarche sincère et des plus humbles que nous avons pénétré ces terres où la nature et le sacré ne font qu’un, où la vie porte en elle-même tout ce sacré que nous avons, nous occidentaux déracinés, pris soin de séparer : là où nous sacralisons l’immobilité et la mort, ici la sacré est la vie même, la rencontre des mouvements et des forces. Ici la frontière entre le mythe et la réalité n’existe pas. Les légendes et le merveilleux sont partout incarnés, tout est signe, et le monde « visible » et « invisible » sont en perpétuel dialogue. Nous, nous n’avons pas ce langage. Nous ne sommes pas initiés. Mais nous croyons à la fiction. En tant qu’artistes, nous nous jouons de cette frontière entre réalité et fiction. Nous savons que c’est par la fiction que l’on apprend du monde qui nous entoure. Nous aimons soulever le voile des apparences, voyager entre les mondes. C’est donc porteurs de ce langage universel que nous avons suivi cette expédition artistique.
La force du groupe fut notre force à tous. Comme le dit la tradition : le tout fut supérieur à la somme de ses parties. Chacun d’entre nous est allé plus loin qu’il n’aurait pu aller tout seul. Les barrières sont tombées, les disciplines ont disparues. Nous avons tous marché, au sens propre et au sens figuré, dans la même direction et avec le même souci de vivre ensemble cette aventure. Nous nous sommes progressivement délestés de nos bagages d’artistes, nous avons abandonné nos passeports dans telle ou telle spécialité. Notre démarche d’artistes est devenue une marche d’hommes. Nous avons retrouvé la juste place de l’homme : celle d’un être en mouvement, en perpétuel équilibre instable, tendu entre deux infinis, l’infiniment grand d’une nature qui nous dépasse et l’infiniment petit d’une faune invisible mais non moins envahissante. Nous avons tous été confrontés aux mêmes peurs ancestrales, celles de l’inconnu et du risque pour sa vie. Nous avons éprouvé nos corps. Nous les avons laissés prendre le relais de l’intellect. Ce sont eux qui nous rappelés d’où nous venions. Ce sont eux, nos corps, qui nous ont ancrés dans un temps présent en dehors de tout temps : nous avons vécu coupé du monde tout en étant au centre même de celui-ci, dans une superposition des mondes où la vie prend toute sa valeur, dans ce cadre fragile et pourtant si puissant d’une nature plus forte que nulle part ailleurs.
Nous avons alors tous ressenti l’ambigüité qui nous compose. Que l’on soit français de la vielle Europe ou Equatorien, nous avons tous vécu cette dualité née du sentiment d’une double appartenance. Nous nous sommes sentis d’ici et de là-bas, le corps dans la nature et la tête dans la culture, et inversement. De notre héritage de « conquistadors », un certain malaise a pu pointer dans nos consciences. Mais de notre désir de partager est aussi né un échange riche et salvateur avec les communautés rencontrées. Personne ne semble échapper à cette ambigüité, tout le monde connait les deux mondes, tout le monde porte en lui cette double appartenance. La seule différence entre chacun est le lieu intime où cette confrontation s’opère, mais le métissage est universel.
Cette ambigüité semble donc être la marque même de toute démarche humaine et il serait sans doute vain et utopique de vouloir la combattre. Cette ambigüité est celle que l’on retrouve en nous dans les tensions qui existent entre le désir de progrès et le respect de la nature, entre l’intelligence et l’intuition, entre l’animalité et la raison, entre la nature et la culture. Il nous fait l’assumer au risque sinon de n’être que des pantins d’une pantomime utopique. L’homme est double, à la fois créateur et destructeur, doué d’un pouvoir dont la puissance le dépasse. Il est temps d’arrêter de jouer à l’apprenti sorcier et d’écouter de nouveau le sage qui nous rappelle à l’ordre. Notre place n’est pas centrale. Comme des enfants gâtés, nous avons voulu tout posséder et nous avons tout eu. Notre mère, notre mère nature, s’est pliée en quatre, s’est sacrifiée, pour nous. Aujourd’hui, elle est épuisée, elle ne peut plus donner. Il faut inverser l’effort, baisser la tête et remonter nos manches, modestement mais résolument.
Car oui, il était encore possible de découvrir quelque chose dans ces terres sacrées où se sont menées tant d’expéditions scientifiques par le passé. Mais la découverte que nous avons faite n’était pas celle attendue. Nous avons découvert que ce que nous cherchions nous l’avions depuis notre départ : notre lien à cette nature à cet universel en nous. Nous avons découvert que plus nous rentrions en nous-mêmes, plus nous pouvions découvrir le monde dans toute son ampleur. Là d’où nous venons nous appartenons. Nous avons découvert que nous étions comme cette plante qui se fane quand elle est mise sous verre et nous avions oublié que, privés de notre milieu fertile, nous allions tous finir fous !
Julie Cloarec-Michaud
Texte philosophique 8 – Touffu-foutu
10 octobre 2018Petite philo-fable librement inspirée de la mythologie grecque et du dieu Kaïros, dieu qui incarne l’esprit du moment opportun, de l’instant à ne pas louper.
C’est l’histoire d’un petit homme. Il s’appelait Kaïros. Il n’avait pas de cheveux à l’exception d’une épaisse touffe à l’avant de sa tête. Il avait un don. Outre qu’il avait les talons ailés, ce qui, ma fois, est déjà un don qui ferait plus d’un jaloux ici-bas, il possédait une capacité toute particulière qu’aucun de ses camarades n’avaient. Kaïros savait ce qu’il fallait faire au bon moment. Il savait par exemple quand et comment les hommes devaient semer et fertiliser leur champ pour avoir la meilleure récolte, quand et comment il fallait arroser les champs pour que les plantations donnent leurs meilleures productions, ou encore quand et comment il fallait faire les récoltes pour en avoir le plus possible avant que le temps ne vire et en gâche une partie. Aucun savoir ne lui faisait défaut. Ce don était très utile, et tout le monde en profitait.
Cependant, pour savoir ce que Kaïros savait, il fallait être habile ! Il y avait un jeu. Kaïros devait se déplacer le plus vite possible, et celui qui voulait connaître son savoir devait l’attraper au vol par sa touffe de cheveux. C’était l’attraction ! Tout le monde se bousculait comme dans une fête foraine pour pouvoir avoir l’occasion d’attraper Kaïros au passage ! Et à chaque fois qu’il était attrapé, Kaïros se faisait une joie de répondre à la question de l’heureux gagnant. Il était infatigable, rien ne l’épuisait, ni la course, ni les questions que tout le monde lui posait. Ce n’était pas un effort pour lui. Il voyait que les hommes étaient contents et il savait que son savoir devait être partagé, car qu’aurait-il pu faire de toutes ces connaissances tout seul ?
Si seulement Kaïros avait su ce que les hommes feraient de tout ce savoir… Tout le monde n’avait pas l’endurance de Kaïros ! Et les hommes avaient de moins en moins de questions à lui poser. Ils savaient tout ce qu’ils voulaient. Ils étaient devenus riches et leurs champs étaient devenus immenses. Kaïros continuait sa course mais les hommes le laissaient passer de plus en plus sans même chercher à l’attraper au passage. Et puis un jour, ils ne l’ont plus attrapé du tout. Ils n’ont même plus fait attention à lui. Ils se sont sans doute dit que leur savoir et leurs connaissances étaient suffisants pour vivre ainsi jusqu’à la fin des temps.
Or, ce que les hommes n’avaient pas pris le temps de savoir, c’est que le monde qu’ils avaient construit grâce à toutes les connaissances de Kaïros n’allait pas rester ainsi pour toujours, et que ce qui allait se passer n’allait pas les rendre heureux jusqu’à la fin des temps ! En effet, tout se dérègla. Il y eu des tempêtes. Il se mit à faire très chaud, et très froid, et puis encore chaud, et ainsi de suite sans que personne ne comprenne pourquoi. Rien d’étonnant, plus personne n’interrogeait Kaïros ! Il pleuvait moins qu’avant mais quand il pleuvait c’était le déluge, et toutes les récoltes étaient foutues. Le blé ne poussa plus. Puis l’orge et puis toutes les autres cultures cessèrent de pousser. Comme les hommes avaient coupé les forêts pour agrandir leurs champs et qu’ils avaient dévié le cours des ruisseaux pour irriguer leurs plantations, il ne resta bientôt plus qu’une immense plaine remplie de boue qui séchait au soleil.
Les hommes étaient perdus. Ils ne savaient plus quoi faire…
Si un de ces hommes avait pris la peine d’attraper Kaïros une dernière fois avant qu’il ne soit trop tard, et s’il lui avait demander tout simplement : « Comment puis-je faire pour que ma vie reste ainsi, maintenant que j’ai tout ? », il aurait entendu cette réponse : « Tu te trompes si tu croies que tu as tout, tu n’as rien ! Quand vous aurez coupé le dernier arbre, pollué le dernier ruisseau, pêché le dernier poisson, alors vous vous apercevrez que l’argent ne se mange pas »[1]. L’homme aurait alors vu son erreur. Il aurait compris, pour la première fois, ce que Kaïros essayait de leur dire depuis le début : « La terre ne vous appartient pas, vous ne possédez rien, mais vous pouvez être heureux de la cultiver en la respectant car c’est d’elle que je tiens tout mon savoir ».
Il parait que désormais la seule touffe d’herbe que l’on voit sur Terre se trouve sur le crâne d’un petit homme aux pieds ailés qui ne cesse de courir sans être jamais rattrapé…
Julie Cloarec-Michaud
Moralité d’indien :
« Nous autres, les indigènes, avons toujours aimé et respecté la nature. Que les hommes tentent de la modifier nous préoccupe énormément. Sachez qu’il est toujours plus délicat de rétablir l’équilibre naturel que de produire un déséquilibre. L’homme n’est pas né sur Terre pour corriger la nature, mais pour en être le fidèle gardien ».
[1] Citation attribuée à Sitting Bull, chef Sioux de la tribu des Lakotas Hunkpapas, connu notamment pour sa résistance face à l’armée américaine durant la bataille de Little Bighorn en 1876.
Texte philosophique 7 – Kaïros
10 octobre 2018Notre expédition a répondu aux exigences du « kaïros ». Mais le « Kaïros » kezako ?
Tout d’abord c’est un petit dieu touffu de la mythologie grecque. Il est le dieu du temps opportun, qui se différencie de Chronos qui est le dieu du temps linéaire. Kaïros représente donc le temps qualitatif, là où Chronos serait le temps quantitatif. C’est sans doute à cause de cette différence que le terme « kaïros » s’est mis à qualifier une aptitude bien plus qu’une chose.
Il a donc fallu que l’on sache, nous autres « explorateurs », faire preuve d’adaptabilité pour nous rendre disponibles aux événements qui se sont présentés à nous. Parce que c’est ça le Kaïros, c’est la rencontre entre deux possibles : un moment avec une envie, un lieu et un espace avec une action. Trouver et provoquer le Kaïros est notre effort. L’attention et l’intuition sont nos guides. La passivité n’a pas sa place, mais l’autorité trop directive non plus ! Nous devons avancer modestement mais résolument, sans attente mais pas sans désir, afin de produire non pas une œuvre dans le temps mais « une seconde d’éternité »[1].
J. C-M.
[1] ROMEYER DHERBEY (Gilbert), La parole archaïque, PUF, Paris 1999, p. 11-12.
Journal de bord 8 – L’atelier de haut en bas
10 octobre 2018Le 6 octobre, sur un flanc du volcan Ruca Pichincha.
Les nuages qu’ils ont vus naître dans la jungle rattrapent les artistes en remontant la vallée de Quito. À 4 000 m d’altitude, avec le soleil absent, une vaste monochromie brune et verte les accueille entre ciel et roche. « Le vide et le plein s’appellent, ils se révèlent », remarque le peintre, Serge.
Les flancs du volcan sont revêtus de páramo, une herbe dense et rase que les danseurs foulent sensuellement parmi l’hostile et le grandiose. Leurs jambes y poussent, cisaillent l’air : ils expérimentent in situ leur rapport à l’espace. Même à quatre et photographiés en plan large, ils demeurent infimes et s’essoufflent. Après la forêt amazonienne et son plein d’oxygène, au sommet des Andes, l’élément O leur manque. Comme eux, au lieu de se développer en hauteur, la végétation là-haut croît au ras du sol.
Puis, ils se balancent dans le vide au-dessus de Quito. Une planche, deux cordes et un volcan leur suffisent pour voir défiler à l’envers, puisqu’ils sont des enfants et qu’ils renversent la tête en arrière, l’ancienne cité inca, ce jour-là comme recouverte de cendres à travers les nuages.
Un arbre, un seul, habite ce domaine, et lui seul est à leur échelle. C’est l’arbre à papier. Son tronc tout fin, si dur, est pourtant constitué de feuilles dorées qui partent au vent. Serge en emporte sans savoir ce qu’il en fera. Ces lumières qu’il chérit au premier coup d’œil, sitôt parties, il se contente de les regarder pour en garder l’impression qu’il recyclera dans son atelier où l’esprit est indissociable de sa main.
Lointains, pentus, cassés, les horizons aperçus du volcan sont difficiles à rendre, alors Didier le photographe recourt à l’avant-plan. « Avec un bon portable, aujourd’hui, n’importe qui peut faire de super photos, dit-il. Mais l’œil, cet outil magnifique, encore inégalé, voit à la fois le large et le serré. Il restitue la beauté au cerveau », conseille-t-il à Luis, l’étudiant devenu bon gré mal gré son apprenti au cours de notre péripétie.
M.-H. A.
Journal de bord 7 – Face au public, face à soi
10 octobre 2018Quito, le 5 octobre. Il fait nuit fraîche. Face à la centaine de spectateurs de l’Alliance française, nous nous retrouvons juchés sur un muret du parking de l’institution, tous les onze, en rang, faisant une dernière performance avant le salut final. Intercalés entre les huit danseurs qui se meuvent comme les lianes le long d’un arbre, nous autres respirons de façon saccadée et feignant d’avancer comme pour s’extirper de son système racinaire, ainsi que nous l’avions fait, le 2 octobre, au pied de l’arbre millénaire.
Le 3, nous avions déjà restitué de nos expérimentations artistiques dans la jungle aux étudiants de l’Université régionale d’Amazonie (IKIAM). Le choc sensitif voulu a eu lieu. À Quito aussi. Il pourrait avoir des conséquences “au-delà de l’urgence écologique”, selon la formule d’Hervé.
Le projecteur du parking nous aveugle. On repense au mythe kichwa de la lune qui absorbe attire les oiseaux trop bruyants ainsi que les prétentieux, croyance similaire au mythe d’Icare et de la fable du corbeau et du renard. On se prend à rêver que la lune, un soir, aspire dans son orbite l’ensemble du parc automobile mondial. Un tel essaim ferait plaisir à voir. À force d’écouter des histoires de vieillards qui se transforment en anaconda pour chasser la nuit, on finit par croire aux miracles.
La performance à l’Alliance a débuté dans le hall d’entrée investi par les danseurs mêlés au public. Puis s’est poursuivie à l’extérieur où Omar a fait fureur auprès des enfants déguisé en insecte plastique avec sa lampe frontale sous un masque de bidon découpé, tandis que Rodrigo a fait rugir le fleuve Napo avec de simples pierres entrechoquées; quelques mètres plus loin, Tamia a interprêté sa danse de la pluie près d’un robinet enrobé de papier sulfurisé, une jolie cascade faite de bric et de broc; face au mur du parking, Serge a fini de peindre avec de la terre mouillée des silhouettes humaines disloquées prenant très provisoirement la place allouée aux voitures; à côté, postés de part et d’autre d’un arbre, Julie et Rodrigo ont déclamé sur le choix de la grande raison, celle du corps, ou de la petite, celle des discours flatteurs; puis le public est rentré à l’intérieur du bâtiment où, depuis un couloir, il a revu Julie derrière une vitre, avec un masque à gaz, se tordre au ras du sol, un moment fort emporté par le violoncelle de Rodrigo; et retrouvé Hervé dans le hall, hurlant en silence comme il l’avait fait sur un roc, quelques jours plus tôt, au milieu d’une rivière.
La déambulation a pris fin sur le parking où les danseurs ont reproduit leur ronde autour de l’arbre millénaire, cette fois autour de la base d’un tronc mort. C’est là que nous avons distribué au public des bouteilles en plastique et d’autres déchets en les invitant à les jeter dans le tout petit espace vert où évoluaient les danseurs. Certains n’ont pas osé, ou pas pu, d’autres s’en sont donnés à cœur joie. Tous se sont ensuite précipités pour ramasser les ordures.
La ficelle est un peu grosse, mais efficace. A l’Université régionale d’Amazonie aussi nous avions sollicité l’interaction du public, qui nous avait lancé des bouteilles vides alors que nous rampions dans une fosse de leur campus, en y interprétant les êtres ambigus que nous sommes: consommateurs-pollueurs et conscients-tristes de l’être; spirituels et pratiques jusque dans l’égoïsme le plus cynique.
Là-bas comme à Quito, un échange avec le public a eu lieu après la performance. Les deux fois, Hervé a expliqué notre but d’expérimenter et non de créer un spectacle, et de nous interroger sur le rôle de l’artiste dans notre société ultra-technologique mais au bilan environnemental catastrophique. Un étudiant nous a demandé nos impressions au contact des communautés indigènes et Rodrigo lui a confié sa déception de constater que celles-ci semblaient considérer leur culture comme faisant partie d’un folklore bon à faire fructifier auprès des touristes. Julie, elle, est revenue sur la question centrale: “Pouvons-nous encore découvrir quelque chose alors que tout semble déjà découvert ? Nous avons découvert que ce que nous cherchions, nous l’avions en nous depuis le début, d’où nous venons nous appartenons”, conclut Julie.
M.-H. A
-