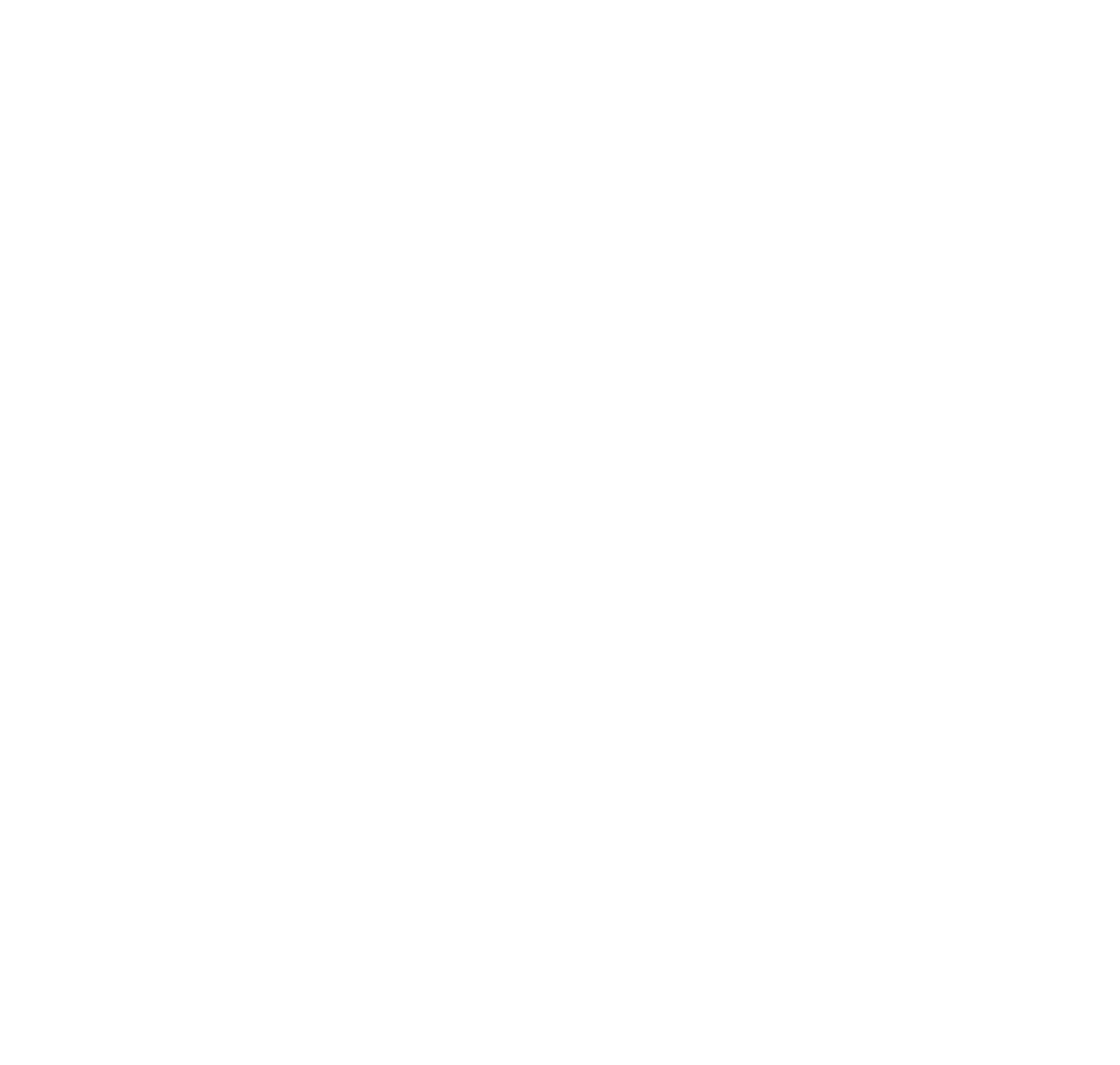Pourquoi ce qui nous est donné à adorer semble toujours mort ? Que ce soit les icônes religieuses, qui n’ont de vivant que la représentation d’un visage cloné à l’infini et imprimés à la chaîne, ou qu’il s’agisse des œuvres d’art enfermées et empilées dans les musées, plus rien de ce que l’on vénère n’appartient à notre monde.
Pourquoi mettons-nous ce que l’on aime si loin de nous ? Nous avons tellement éloigné le sacré de l’homme que ce dernier s’est lui-même construit des cases pour y figer ces objets. Sans doute cela est plus pratique… comme une sorte de consommation du sacré « à emporter » ou « à livrer », où chacun peut aimer ce qu’il veut, quand il veut, où il veut. Tout est à la carte, tout est fragmenté et transportable.
Nous espérons trouver notre propre sens à la vie en collectionnant tous ces échantillons, en les composant de telle manière à former notre propre paysage sacré, notre monde à nous, en miniature, pour rentrer dans nos petites maisons, isolés les uns des autres, pour ne pas se gêner, pour ne pas s’influencer, diront certains au nom de la « liberté », ou peut-être plutôt pour ne pas devoir tout recommencer après avoir vu notre fragile construction de sens s’écrouler. Nous sommes seuls. Chacun devant son petit monde, sous cloche, à le regarder se dessécher, comme une plante qui manque d’eau, arrachée à son milieu fertile, arrachée à ce qui la rend vivante.
Il est temps de soulever la cloche, d’abattre les murs, de remettre les pieds sur terre aux icônes ! Nous nous acharnons à chercher du sens sans cesse en multipliant nos efforts et en nous divisant, chacun à la poursuite de sa propre quête. Nous nous isolons et nous nous rétrécissons à mesure que nous avançons, sans nous rendre compte que, comme dans la fable, ce que nous cherchons, nous l’avions au départ et autour de nous : dans la nature. Là d’où nous venons, nous appartenons. Nous n’avions pas compris que nous étions comme cette plante qui se fane une fois mise sous vide et que privés de notre milieu fertile nous risquions de devenir fous.
Il est temps de recréer un pont entre le vivant et le sacré, entre la vie et le sens car « [on] verra alors que la nature est le symétrique de l’âme, et qu’elle lui répond point par point. L’une est le sceau, l’autre l’impression de ce sceau. La beauté de la nature est aussi celle de l’esprit […]. Les lois de la nature sont aussi celle de cet esprit. La nature devient alors pour [nous] la mesure de [nos] accomplissements. Ce que [l’on] ignore de la nature est aussi ce que [l’on] ne possède pas encore de [notre] propre esprit. Et c’est ainsi que, in fine, le vieux précepte, « Connais-toi toi-même », et le nouveau précepte, « Étudie la nature », deviennent enfin une seule et unique maxime »[1].
Julie Cloarec-Michaud
[1] EMERSON (Ralph Waldo), « L’Intellectuel américain » in Essais, Michel Houdiard Editions, Paris, 2000, p. 16.